
En Belgique, durant le mois de juin 2022, le petit monde médiatico-politicien a bruissé autour du débat bruxellois sur l’interdiction de l’abattage sans étourdissement. Passons pour l’instant sur le fait que ce débat aurait mérité une analyse matérialiste, humaniste et émancipatrice et arrêtons-nous sur un autre fait : que d’autres étourdissements et boucheries se déroulent. Relevons simplement que l’actualité est en permanence, ou presque, accaparée par de tels débats mal emmanchés… Celui-ci, comme les autres, mériterait une analyse en soi, mais nous nous égarerions...En ce mois de juin 2022, nous en sommes au « mois 28 » de l’ère des pandémies. Cette période de 28 mois a été particulièrement riche en enseignements.
Au début de cette ère, la plupart des dirigeants politiques ont commencé par minimiser de manière criminelle la pandémie du COVID-19 : il fallait se montrer rassurant, « attendre », préserver l’activité économique. Chaque fois que ça a été nécessaire, les « autorités » ne se sont pas bornées à nier l’évidence de la gravité de la situation. Elles ont aussi décrédibilisé de simples mesures de protection, comme le port d’un masque, au motif que ces masques avaient été massivement détruits et étaient introuvables.
Mais les faits sont têtus, et rapidement, les systèmes de soins de santé se sont retrouvés à l’agonie, coincés entre les coupes sombres effectuées pour satisfaire aux exigences budgétaires et l’affluence de milliers de patients en mauvais état de santé. L’activité économique à préserver allait de toute manière se retrouver à l’arrêt. Donc, virage à 180 degrés: confinement, arrêt de toutes les activités « non essentielles », soutien financier massif à l’économie, 30 milliards d’euros en Belgique, 600 en France, répression aveugle, en particulier envers les plus exploités d’entre-nous, qui avaient le mauvais goût de ne pouvoir partir profiter du jardin de leur maison de campagne…
L’année 2021 aura été celle de la vaccination. Après un an à se contredire sans cesse, à faire usage de propagande, à être incapable de comprendre une pandémie comme une question collective et donc à culpabiliser les individus, indépendamment de leur condition, et bien devinez quoi, les campagnes de vaccination, outil dont l’efficacité est d’autant plus élevée qu’elle est collective, ont longtemps patiné.
À la fin de l’hiver 2021-2022, la pandémie semble maîtrisée. Les plans de soutien à l’économie ont formidablement fonctionné, au point que celle-ci surchauffe : des pénuries se profilent et le prix des combustibles augmente de manière vertigineuse en raison de la reprise de la demande dans une économie complètement libéralisée. Nous sommes nombreux à grelotter, tentant de limiter la casse face à l’explosion des factures de gaz et d’électricité. Sous le capitalisme, rien n’est jamais ni bon ni mauvais : tout est opportunité. Le problème est que ces opportunités correspondent à une augmentation sévère du coût de la vie, par propagation des factures énergétiques le long des chaînes de production.
Nous savons déjà depuis plusieurs mois que nos gouvernants vont nous faire payer la facture du soutien à l’économie, soit de ce qui a permis le formidable enrichissement des capitalistes, et cette facture est alourdie par la flambée des prix.
C’est à ce moment-là que le Président russe Poutine décide d’agresser l’Ukraine, au terme d’années de tensions régionales et géopolitiques avec les États-Unis, par pays d’Europe centrale interposés.
L’Europe occidentale se retrouve ramenée plus de trente ans en arrière, en bouclier du monde libre face à une Russie « conquérante ». Plutôt que de prendre acte de ce que nous nous trouvons entre deux impérialismes, que, quoi qu’il arrive, nous resterons voisins de la Russie, nos dirigeants enfilent leur costume de petits soldats de l’OTAN, bandent leurs muscles et sont déterminés à faire plier la Russie par tous les moyens, soit un train de sanctions, économiques principalement.
Nous sommes exposés, comme les habitants d’une grande partie de la planète, aux risques de pénurie alimentaire. De surcroît, l’incurie de nos dirigeants en matière énergétique, le recours continu et massif aux énergies fossiles, nous mettent en état de dépendance à cette même Russie que nous nous préparons à tenter de faire mettre genou à terre. Rude tâche.
Elle aura un coût écologique exorbitant, sur lequel il faudra revenir.
Mais elle a un coût financier colossal, et ce coût, nous devrons le payer, avec un coût humain tout aussi colossal pour les populations, les plus exploité.e.s en particulier.
Mais un autre problème se profile, à peu près totalement passé sous silence.
Nous vivons, depuis dix ans, dans un monde financier très particulier. Suite à la crise des subprimes, produit d’un capitalisme qui n’a eu de cesse de se débrider, suite à la crise des dettes publiques européennes qui s’en est suivie, le coût du crédit pour les pouvoirs publics était devenu nul ou même négatif, ce qui a permis aux États européens riches (Allemagne, Pays-Bas, France, Luxembourg, Autriche, Belgique,…) de ne pas trop se préoccuper de leurs emprunts. C’est ce qui a permis de passer sans trop de problème (pour les États) au-dessus de la crise du COVID. Ces conditions ne venaient pas de nulle part : elles étaient le résultat des politiques monétaires européenne et états-unienne visant à soutenir une économie atone.
Problème : cette période a pris fin avec l’agression de l’Ukraine par la Russie. Les taux d’intérêt ont littéralement explosé. Cela a deux effets qui se renforcent mutuellement.
Le premier est simple à comprendre : les budgets des États vont devoir supporter à nouveau des charges d’intérêt importantes, d’autant plus importantes que les finances publiques ont été mises à mal pour maintenir le capitalisme a flot pendant la crise du COVID.
Le second est encore plus pervers. Ces hausses de taux d’intérêt rendent les dettes plus difficiles à rembourser, ce qui met la pression sur les États, de l’Union Européenne en particulier, pour avoir des « finances saines ».
Après avoir porté la charge humaine de la crise du COVID, alors que pesait déjà sur nous la menace de devoir régler la facture et que nous sommes déjà soumis à une inflation très élevée, nous allons maintenant être confrontés à des États qui vont nous expliquer l’importance de se serrer la ceinture, alors que beaucoup d’entre-nous sont financièrement exsangues.
Gageons que les tentatives de nous étourdir ne vont pas manquer. Le « débat » sur l’abattage sans étourdissement en était une. Le « débat » sur l’immigration en est une autre qui fonctionne toujours bien : « c’est la faute de... ». Mais la boucherie qui se profile s’annonce particulièrement sanglante.
Une boucherie n’empêche cependant pas tout le monde de s’amuser : celle-ci donnera lieu à une dramatisation puis à la Xème représentation d’un sempiternel spectacle de nos clowns tristes des différents niveaux de pouvoir, à commencer par ces socialistes et écologistes qui ne manqueront pas de nous assurer de leur solidarité, de manifester contre eux-mêmes (comme ils viennent encore de le faire), pour réclamer aux gouvernements dont ils font partie des « mesures fortes qui répondent aux attentes de la population », de s’enfermer durant de longues nuits de négociations aux termes desquels elles et ils paraîtront, au petit matin blême, pour nous expliquer que « l’essentiel a été préservé », comprendre : « nous restons au gouvernement, nous allons continuer notre petit jeu, nous préservons nos petites entreprises que sont nos partis avec leurs armées d’employés et sans nous, ce serait pire ».
Cette boucherie ne cessera pas tant que suffisamment d’entre-nous ne se dresserons pas contre sa cause primaire : un système capitaliste intrinsèquement psychopathique. Se dresser contre lui a un coût. La question est de savoir jusqu’à quand nous éviterons de le payer...




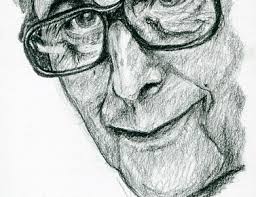
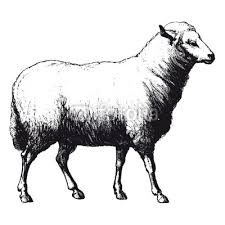
 Flux RSS
Flux RSS
